Il a fallu attendre quatre années aprèsRéparer les vivantspour que Maylis de Kerangal refasse son apparition sur la scène littéraire avec un nouveau roman : Un monde à portée de main. C’est peu dire que l’auteur(e) était attendue au tournant !
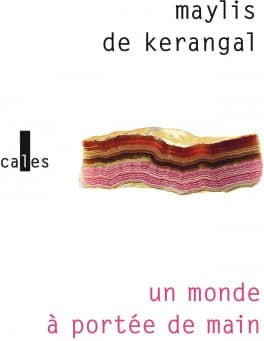
J’ai adoré Réparer les vivants que j’avais chroniqué pour l’Express à l’époque où j’étais membre du jury des lecteurs de l’Express/BFMTV. J’avais d’ailleurs rencontré Maylis, pas peu fière de lui dire en direct combien son livre m’avait touchée, confondue, blufée.
Là c’est au monde de la peinture en trompe l’oeil qu’elle s’attaque avec la même précision chirurgicale qui est sienne dans l’usage du vocabulaire spécialisé. Paula Karst, son héroïne, s’inscrit à un cours prestigieux de la rue du Métal à Bruxelles. Un peu par hasard, dans les errances de sa vie estudiantine, sans vraiment d’objectif. On retrouve là la jeunesse, sa fougue, son impertinence, ses débordements, sa loose, son vocabulaire, dans une sorte de roman d’apprentissage revisité. Pas de discours direct, tout est au discours rapporté, mais les mots sonnent justes et le ton est là.
Paula se laisse prendre au jeu de la peinture, du trompe-l’oeil, qui très vite s’avère ne pas être un jeu, mais un travail harassant qui use les yeux, le corps. La copie des peintres dans une souffrance, dans la tension d’un rendu parfait. Joli personnage que cette dame au « col roulé noir » qui dirige l’école, austère et exigeante, et épuise ses étudiants pour les révéler.
En parallèle, il y la vie de jeune fille de Paula, sa colocation avec un autre élève de l’école, Jonas, personnage énigmatique, peu loquace avec lequel elle tisse une relation d’apprenti, un peu à la manière des Compagnons, puis plus sensuelle.
Et pourtant la mayonnaise ne prend pas : trop d’énumérations, trop de précisions.
On se fait rapidement l’effet d’être dans un de ces manuels que compulsent les élèves :
« Mi-novembre, on attaque les marbres. Carrare, grand antique, labrador, henriette blonde, fleur de pêcher ou griotte d’Italie … »
Et un peu plus loin : » les pierres semi-précieuses, les lapis et les citrines les topazes et les jades, les améthystes, les quartz, en février le dessin, la perspective, puis les moulures et les frises, les plafonds de style et les patines, en mars, la dorure et l’argenture, le pochoir, le lettrage publicitaire et enfin le diplôme ».
Cette lassitude de l’écriture, on croit même la percevoir chez Maylis de Kerangal qui, page 114 fait une large ellipse narrative « Elle (Paula ) finit par rentrer. Passe encore deux ans entre Rome (…) et le Nord de l’Italie… » qui contraste fortement avec la lenteur du récit et des descriptions jusque là. On sent qu’il est temps de boucler l’histoire, de faire se rejoindre Jonas et Paula et d’en finir avec l’illusion, non pas du trompe-l’oeil mais de l’écriture.
Maylis de Kerangal ne s’adresse pas au lecteur lambda, il faut s’acharner pour poursuivre la lecture et ça, ça n’est jamais bon signe. Et puis parfois, le récit part en vrille et on se demande ce que l’auteur veut nous signifier, « Elle se souviendrait avoir compris que peindre c’était d’abord ne pas peindre, mais sortir dans la rue et aller boire une bière ».
Si peindre n’est pas peindre, alors écrire n’est pas écrire. Leçon de tout ça : boire une bière, surtout en Belgique, est un acte créatif.
Aux Editions Verticales
Dominique Mallié
