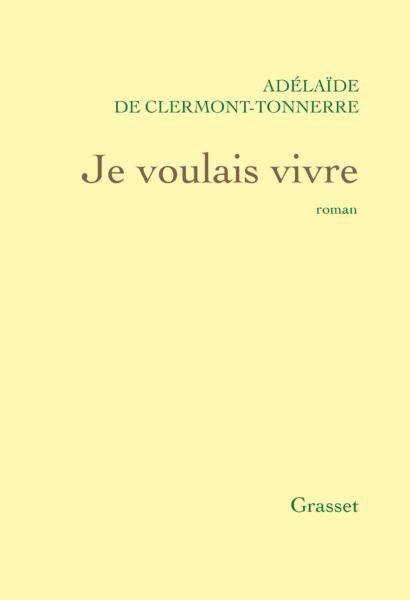Longtemps réduite au rôle de femme fatale, Milady des Trois Mousquetaires retrouve, sous la plume d’Adélaïde de Clermont-Tonnerre, sa complexité et sa voix. Dans Je voulais vivre, l’archétype devient une héroïne moderne à la lumière des combats féminins d’aujourd’hui.
Rencontre avec Adélaïde de Clermont-Tonnerre
Votre roman est un geste littéraire fort : défense du romanesque, hommage à Dumas et réhabilitation de Milady. Pourquoi ce choix, et qu’avez-vous voulu transmettre en redonnant chair à ce personnage longtemps stigmatisé ?
Adélaïde de Clermont-Tonerre : « Depuis Fourrure, Le dernier des nôtres, Les jours heureux, je défends une certaine idée du roman : j’aime les histoires et la fiction. En France, cette veine a longtemps été méprisée, supplantée par l’autofiction et “l’obsession du fait vrai”. Pourtant, les sociétés comme les individus reposent sur des récits. Comme le rappelle magnifiquement Rebecca Dautremer et Anik Le Ray dans le film Kérity, la maison des contes : “Ce n’est pas parce que c’est inventé que ça n’existe pas.”
Dumas en est l’exemple éclatant. Longtemps jugé “populaire” et suspecté parce qu’il écrivait en atelier, il fut un immense inventeur de formes et de personnages, un “showrunner” avant l’heure. On lui reprochait de déléguer — pose-t-on la même question aux peintres de la Renaissance ? Ce qui faisait sa grandeur, c’était ce supplément de génie : l’humanité, le souffle, le dialogue.
Avec Je voulais vivre, j’ai voulu accomplir un triple geste : exprimer mon amour pour Dumas, réhabiliter un patrimoine injustement déclassé, et prolonger le romanesque comme une énergie vitale dont nous avons plus que jamais besoin.
Et puis, il y avait Milady. Dans Les trois mousquetaires, elle fascine mais reste secondaire, privée de la même humanité que ses pairs masculins. Mon pari a été d’en faire un vrai sujet, une femme entière — ni sainte ni diablesse — traversée par ses colères, ses failles et ses désirs. Dumas l’avait créée en puissance, mais sans lui donner voix. J’ai déployé ce qu’il avait esquissé à travers une voix féminine, pour rappeler qu’aucune histoire n’est figée et qu’un récit né masculin peut devenir féminin, sans perdre de sa force. »
Milady : le plus grand féminicide de la littérature française
Vous racontez qu’un déclic est venu en entendant Milady qualifiée de « perverse » à quinze ans. Comment ce choc a-t-il nourri votre indignation et guidé votre réécriture ?
Tout est parti d’un moment de sidération. J’écoutais avec mes enfants une adaptation audio des Trois Mousquetaires : “Milady, cette perverse qui, à quinze ans, détourne un prêtre du droit chemin.” Quinze ans, c’est une enfant ! Qui détourne qui ? Moi qui avais lu et relu Dumas sans éprouver d’empathie pour Milady, j’ai compris que quelque chose clochait.
En relisant, tout devient évident : marquée au fer sans jugement ; rejetée par Athos sans qu’on lui laisse le temps de s’expliquer ; abusée par d’Artagnan qui la trompe sur son identité — aujourd’hui, on parlerait de viol. Racontée du point de vue des hommes, elle reste un le péché originel. Mais si l’on se place de son côté, on est bouleversé : comment avons-nous pu passer à côté du plus grand féminicide de la littérature française ?
C’est la même logique que dans notre société : des femmes qui appellent à l’aide, qu’on n’entend pas ; des plaintes classées ; et un jour, il est trop tard. De tout temps, la femme a été désignée coupable : Ève, Pandore, Hélène… toujours responsables des maux du monde ? Pourquoi cette idée tenace que le corps des femmes appartient aux hommes ?
Avec Je voulais vivre, j’ai voulu faire de Milady non plus un objet de désir ou de condamnation, mais un sujet. Une femme complexe : ni victime pure, ni prédatrice. Traversée par ses contradictions, ses désirs, sa rage, sa résilience. J’ai dédié ce livre à toutes celles qui nous ont précédées, et aux hommes qui les ont aimées et défendues. Parce que chaque liberté conquise par elles nous permet aujourd’hui d’écrire, de penser et de transmettre autrement. Et si Milady proclame “je ne suis pas de celles qui pleurent…”, elle découvre aussi que la vengeance ronge tout : l’ambivalence était essentielle à montrer.
Richelieu, souvent caricaturé, devient sous votre plume celui qui reconnaît l’intelligence de Milady et lui offre une mission politique. Pourquoi ce paradoxe vous tenait-il à cœur ?
Adélaïde de Clermont-Tonnerre : Richelieu a souvent été réduit à l’image du manipulateur, mais il fut surtout un immense homme d’État : fondateur de l’État moderne, créateur de l’Académie française, propriétaire de la plus grande bibliothèque d’Europe. Contrairement aux mousquetaires, qui trahissent leur serment, il agit pour la stabilité du royaume.
Milady, en servant Richelieu, sert donc l’État français. Et c’est lui qui reconnaît l’intelligence de Milady et lui confie une mission politique. Là où les autres hommes l’abaissent, il lui donne une place. C’était essentiel pour moi de montrer ce paradoxe : c’est souvent dans les interstices du pouvoir qu’une femme peut exister et se faire entendre.
Rendons aussi justice à Dumas : même si Milady reste archétypale, il a inventé une figure féminine d’une puissance inouïe. Espionne, stratège, agente du pouvoir, elle compte parmi les premières femmes véritablement puissantes des lettres françaises. Peut-être parce que lui-même était un outsider : fils d’un général métis, petit-fils d’une esclave, orphelin, il n’appartenait pas aux cercles établis. Cette marginalité lui a permis de créer des personnages flamboyants, et de donner même à Milady la possibilité d’exister.
Les diktats de la virilité abîment aussi les hommes
Votre roman montre aussi des hommes prisonniers des codes virils de leur temps. En quoi était-il important d’ouvrir ce champ sur les masculinités et l’équilibre femmes-hommes ?
Je ne crois pas à la guerre des sexes, mais aux ponts. Les diktats de la virilité abîment aussi les hommes. D’Artagnan, héros solaire, finit par douter : le vrai courage, c’est cela — avoir la force morale de se poser des questions. J’ai voulu montrer une galerie de masculinités nuancées : le premier prêtre, bienveillant, incarne la protection ; le second, la condamnation ; Rochefort, en voyant la marque, ne juge pas mais demande “Que s’est-il passé ?” — c’est la réaction juste. Ce fils qui embrasse l’épaule de sa mère incarne déjà une autre manière d’être un homme.
Je suis mère de deux garçons et je crois à la transmission. Un jour, en lisant un manuel d’histoire pour enfants, l’un d’eux m’a dit : “Ton livre est ennuyeux, il n’y a que des rois, jamais de reines !” Cela m’a bouleversée. Ces détails comptent : ils font bouger les représentations.
Aujourd’hui, je m’inquiète des replis masculinistes autant que des rejets en bloc du masculin. L’avenir passe par l’écoute réciproque et la reconnaissance mutuelle. Il n’y a pas une seule façon d’être un homme, ni une seule d’être une femme. L’équilibre se construit dans la nuance et l’attention à l’autre, pas dans les tranchées.
Réécrire Milady, est-ce aussi l’affirmation qu’une histoire pensée au masculin peut s’incarner dans une voix féminine avec la même force ?
Absolument. Ce roman est à la fois un hommage et une réinvention. Une déclaration d’amour à Dumas. Je me suis glissée dans son atelier, dominé par les hommes, pour donner voix aux femmes. Milady avait été inventée en puissance, mais sans recevoir la même humanité que les héros masculins. J’ai pris ce qu’il avait esquissé et l’ai déployé, pour en faire une femme qui parle, pense, désire, doute.
Les classiques vivent parce qu’on les transforme. Chaque époque relit différemment. Aujourd’hui, nous ne pouvons plus voir Carmen comme un simple drame amoureux : c’est un féminicide. De même, la vengeance de Milady, préfiguration de Montecristo, ne peut plus être lue comme une punition légitime. Dumas lui-même a évolué, jusqu’à reconnaître qu’il s’agissait d’un crime.
Écrire, c’est transmettre une énergie vitale. Dumas écrivait en bras de chemise, comme dans un combat physique, et ses personnages ont cette sensualité, cette chair, qui les rendent vivants. J’essaie de prolonger cela : faire vibrer le romanesque dans une voix féminine et montrer qu’aucune histoire n’est figée.
Nous sommes toutes Milady !
Beaucoup de lectrices vous disent : « Nous sommes toutes Milady ». Est-ce aussi votre conviction ?
Oui, et c’est peut-être ce qui m’a le plus touchée. Quand on referme Je voulais vivre, certaines me disent : “Nous sommes toutes Milady.” Non pas qu’il faille lui ressembler, mais parce que nous avons le droit d’être multiples : blessées et puissantes, sensuelles et stratèges, en colère et résilientes. Sortir des cases : la sainte, la muse, la victime… ou la sorcière. Milady incarne tout cela et plus encore.
La réception a été forte : beaucoup de lecteurs m’ont dit qu’ils ne voyaient plus les Mousquetaires de la même manière. Certains hommes ont été bouleversés ; l’un d’eux s’est même fâché que Milady meure, il voulait que je la sauve ! C’est la preuve que notre regard a changé. Ce que nous acceptions hier peut nous choquer aujourd’hui. Et n’oublions pas qu’ailleurs — Afghanistan, Iran, Pakistan — être femme demeure trop souvent une malédiction : raison de plus pour redessiner nos imaginaires.
Ce livre est né d’une indignation, mais porte aussi une espérance : redessiner l’l’histoire au féminin, transmettre aux générations suivantes une vision plus libre et nuancée. Pour que les petites filles d’aujourd’hui n’aient plus à choisir entre Milady ou rien, mais puissent dire simplement : “Chapeau, cette fille.” »
Je voulais vivre, Adélaïde de Clermont-Tonnerre Ce qui m’a frappée d’abord, c’est l’épilogue. Un hommage magnifique à Alexandre Dumas, où Adélaïde de Clermont-Tonnerre semble avoir compris mieux que quiconque la relation difficile et pudique qu’il entretenait avec les femmes. Elle s’empare de ses silences, de ses non-dits, de tout ce qu’un homme du XIXe siècle ne pouvait écrire : la femme libre, insoumise, complexe. C'est là que réside le cœur du roman : rien ne se crée, tout se transforme. La littérature a ce pouvoir inouï : reprendre des personnages, leur prêter une autre voix, réinventer leur histoire. Ici, Milady n’est plus un simple archétype, ni blonde fatale, façon Lana Turner ou Mylène de Mongeot, ni brune vénéneuse façon Eva Green. Elle devient chair, contradictions, blessure et puissance. La première scène est d’une violence suffocante : on sent charnellement les corps masculins qui encerclent, qui dominent, qui étouffent. Et tout le roman se déploie à partir de cette évidence : Milady est plus victime que bourreau. Enfant violentée, épouse rejetée, amante trompée… sa beauté est moins un atout qu’une malédiction. Elle se débat, résiste, mais finit décapitée par Athos — son propre mari. C’est bouleversant. En refermant le livre, j’ai compris que ce que Dumas avait laissé dans l’ombre, Adélaïde venait l’éclairer : le plus grand féminicide de la littérature française. Longtemps, on a trouvé « normal » qu’elle soit punie. Aujourd’hui, après MeToo, nous ne pouvons plus voir les choses ainsi. Nous savons que la violence masculine n’est ni banale ni justifiable.Ce roman n’est pas un essai militant, il garde le souffle romanesque de Dumas, l’énergie vitale de la saga. Mais à chaque page, l’injustice résonne avec notre présent. Et en refermant Je voulais vivre, une seule phrase m’est venue : Milady, c’est nous.
Je voulais vivre
Adélaïde de Clermont-Tonnerre
Grasset, 24 €
Sélectionné au prix Renaudot
Anne Bourgeois
Lire aussi : « La séparation » de Claude Simon, l’événement théâtral de la rentrée au Théâtre des Bouffes Parisiens